|
Toutes les explications qui vont suivre ne sont pas
simples mais essentielles à la compréhension des principes de formation
des ascendances d'origine thermique, celles qui finalement justifient
l'utilisation du variomètre SkyAssistant.
Atmosphère standard type OACI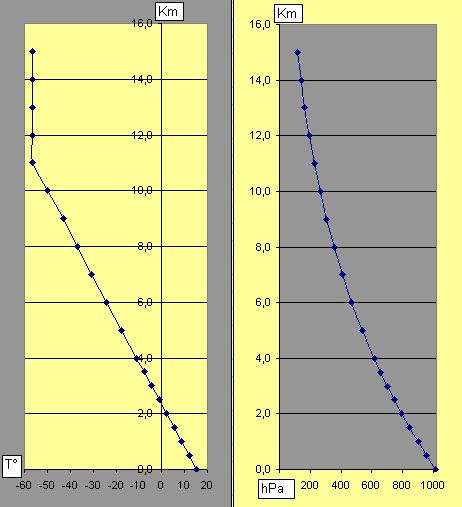
L'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI) définit l'« atmosphère type OACI » comme étant (au niveau de la
mer) 1013,25 hPa, 15°C et 0 % d'humidité. Ces valeurs sont utilisées pour
calculer diverses caractéristiques de performance aéronautique, telles que
l'endurance, le rayon d'action, la vitesse aérienne et la consommation de
carburant. Pour se reporter à une altitude barométrique autre que le
niveau de la mer, la température est ajustée selon le gradient thermique
adiabatique prescrit (qui est de -6,5°C/km pour les premiers 11 km).
En ce qui concerne l'aéronautique :
- Au niveau de la mer, l'air est à 15 °C
et à 1013,25 hPa ;
- La troposphère s'étend de 0 à 11
km ; la température décroît linéairement de 6,5°C par km, elle a
donc une température de -56,5 °C à la tropopause.
L'atmosphère quelconque est semblable à
l'atmosphère standard, mais en diffère sur deux points principaux :
- Le
niveau de référence (surface isobare 1013) n'est plus systématiquement
confondu avec le niveau de la mer mais au contraire "flottant", mobile
verticalement par rapport à lui, dépendant de la structure de la masse
d'air qui surplombe (Air plus chaud => air moins dense => pression plus
faible et inversement).
- Au
niveau de référence, la température t n'est plus égale à 15 °C mais
variable autour de cette valeur standard. La température va évoluer en
fonction :
- Des
caractéristiques de la masse d'air qui nous surplombe dépendant de son
origine (origine polaire => plus froide, origine tropicale => plus
chaude).
- De son réchauffement ou refroidissement au contact du sol
(couche mince de quelques centaines de mètres) en fonction des cycles
nocturnes et diurnes.
La température ne décroît donc pas de manière
linéaire en fonction de l'altitude mais en oscillant de part et d'autre de
cette droite théorique (graphique gauche ci-dessous : comparaison
OACI/sondage), droite qui pourrait
finalement nous servir de régression linéaire de l'évolution de la
température réelle.
Généralement la température décroît avec l'altitude, mais il se peut qu'elle soit
stable en prenant de l'altitude, on parle alors d'isothermie.
Il se peut même qu'elle augmente avec l'altitude, on parle alors
d'inversion.
La couche Convective : du sol jusqu'à
l'inversion.
En partant du sol jusqu'à la tropopause (limite haute
de la troposphère), on peut rencontrer, à des niveaux variables, plusieurs
inversions. La tropopause étant une inversion marquée qui va séparer la
troposphère de la stratosphère.
L'inversion qui va nous intéresser plus
particulièrement sera celle située (en fonction des régions, des
saisons,...,) à une altitude de 800 à 3000m. Cette inversion marquera le
sommet de la couche convective, celle dans laquelle nos planeurs
vont évoluer en vol thermique. Les ascendances qui partent du sol ne
s'élèvent jamais au-delà (sauf orage). Lors de l'apparition de cumulus ,
c'est cette inversion qui stoppera le développement vertical du nuage.
Les mouvement verticaux convectifs vont brasser cette
couche convective uniquement, en y dispersant divers aérosols (poussières,
pollution ...) qui s'y répartiront de manière uniforme. Lors de vols en
planeur les jours de thermiques purs (sans cumulus) on peut distinguer
clairement le sommet de la couche convective, bloquée par la couche
d'inversion. On remarque bien sur la photo ci-dessous une séparation
franche entre la couche convective brumeuse (sous le trait rouge) contenant une concentration en
aérosols 2 fois supérieure à l'air limpide se situant au-dessus.
Je me souviens de certains rares vols en planeur
au-dessus de Besançon des jours de thermiques purs. Une ascendance m'ayant
permis de monter plus haut que la moyenne et donc finalement sortir la
tête au-dessus de cette inversion, me permis de voir la chaîne des Alpes
et le Mont Blanc en particulier.
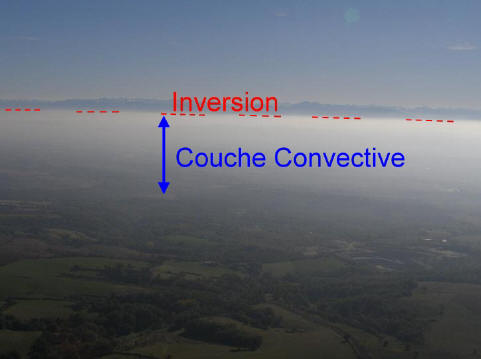
L'emagramme :
Pour mieux étudier la masse d'air, il est important de
relever ses caractéristiques et de les consigner sur un graphique
appelé émagramme. Dans un premier temps, on se contentera de
reporter la température de l'air mesurée à diverses altitudes (T : courbe
d'état) et la température du point de rosée au sol (Td).
Dans un deuxième temps on verra qu'il peut être intéressant d'y consigner
aussi Td à diverses altitudes, si les données sont disponibles.
|
 Emagramme
simplifié Emagramme
simplifié
Sur l'émagramme ci-dessus n'apparaît que l'altitude,
la température et l'adiabatique sèche (courbes vertes).
L'adiabatique sèche est une courbe qui marque l'évolution de la
température d'une bulle d'air qui en s'élevant va se refroidir par
détente (baisse de pression => baisse de température). La détente
adiabatique de la bulle d'air est théoriquement sans échange avec
l'air environnant, on verra plus après que le brassage et la
turbulence générée favorise malgré tout des échanges de température. |
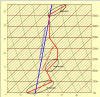 Comparaison OACI /Sondage Comparaison OACI /Sondage
Pour information j'ai placé l'atmosphère standard (bleu) et la courbe d'état
d'un sondage d'une
masse d'air quelconque (rouge). Un sondage est la mesure de la température de
l'air à diverses altitudes. Le sondage peut être réalisé grâce au Skyassistant. |
Concernant notre activité modéliste et plus particulièrement l'utilisation
du skyassistant, l'émagramme simplifié peut être suffisant, en effet le
logger permet d'enregistrer les températures à diverses altitudes pour
constituer notre sondage. Grâce à l'utilisation de l'adiabatique sèche on
pourra pour diverses températures au sol déterminer
le début de la convection, les plafonds associés, la base des cumulus et
l'intensité des ascendances. Dans la mesure ou les activités vélivoles se
cantonnent à l'espace situé sous la base des cumulus, dans air "sec" donc
non saturé, on peut pratiquement arrêter l'étude ici.
Si maintenant on souhaite connaître tout ce qui est au-dessus de la base
des cumulus,
il convient de connaître l'utilisation de l'adiabatique humide ou pseudo-adiabatique qui traite l'évolution d'une masse d'air saturée
(gouttes d'eau en suspension). Puis on verra qu'on peut facilement
déterminer la base des cumulus par des relevés avec une simple station
météo perso ou les données de Météo France.
Pour bien comprendre la suite : une bulle d'air ne peut monter que si elle
baigne dans un air plus froid qu'elle même (air chaud => moins dense
donc plus léger que
l'air froid), dans le même principe que la montgolfière par différence de
densité. Plus l'écart de
température sera important et plus cette ascendance sera puissante. Cette
ascendance arrêtera son ascension dès qu'elle baignera dans de l'air à la
même température ou plus chaud qu'elle même.
Il est noter toutefois qu'un air humide à la limite de la saturation étant plus léger qu'un air sec
(2%plus léger), il peut exister de rare cas d'ascendance déclanchées par ce
phénomène. J'ai dit plus haut : "cette ascendance arrêtera son ascension dès
qu'elle baignera dans de l'air à la même température" ... La bulle d'air
en s'élevant devient plus humide du fait de son refroidissement par
détente adiabatique et se retrouve de fait plus humide que l'air
environnant, donc plus léger à température égale. L'ascendance peut alors
s'élever un peu plus, bien que la température d'équilibre soit atteinte.
Pour avoir un peu plus de recul encore, il faut bien penser que l'air a
une masse (1 kg/m3 environ à 1000m), qu'une petite ascendance peut mettre
en mouvement 10 000 tonnes d'air, cet air ne pourra s'arrêter
instantanément. Notre ascendance de 10 000 tonnes va poursuivre son chemin
sur l'inertie est dépasser l'altitude qui correspond à l'équilibre des
températures puis revenir sur ses pas en redescendant pour se stabiliser
et se disperser.
Adiabatique sèche : (adiabatique)

Lorsqu'une bulle d'air échauffée par le sol va
s'élever (ascendance), celle-ci va se détendre au fil de son élévation et
ainsi perdre de sa température. L'air étant un mauvais conducteur
thermique, les échanges entre cette bulle et l'air environnant vont être
nuls (moindre en réalité), cette détente est dite adiabatique.
Le refroidissement adiabatique est de 1°C / 100m
Adiabatique humide : (pseudo-adiabatique)
Notre bulle d'air précédemment citée va s'élever tant
que sa température sera supérieure à l'air environnant et ce d'autant plus
vite que l'écart de température sera important. En montant, donc en
refroidissant, cet air va atteindre sa température de saturation, la
vapeur d'eau contenue dans l'air va passer à l'état liquide et former ce
qu'on appelle le nuage. L'altitude de saturation dépend exclusivement de
la température de l'air et de la quantité d'eau sous forme de gaz que cet
air contient, on l'appellera "rapport de mélange".
Le refroidissement pseudo-adiabatique est 0.45° à
0.65° / 100m en fonction de la T° et la pression
|

Les pseudo-adiabatiques sont en pointillés verts
|
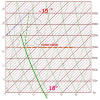 La masse d'air qui part du sol à 18° s'élève en suivant un
refroidissement adiabatique jusqu'à atteindre sa température de
saturation. A partir de là le refroidissement suit la
pseudo-adiabatique. Il y a formation nuageuse, le refroidissement est
moins rapide qu'en air non saturé, ce qui renforce l'ascendance. La masse d'air qui part du sol à 18° s'élève en suivant un
refroidissement adiabatique jusqu'à atteindre sa température de
saturation. A partir de là le refroidissement suit la
pseudo-adiabatique. Il y a formation nuageuse, le refroidissement est
moins rapide qu'en air non saturé, ce qui renforce l'ascendance. |
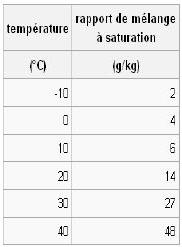 Le
rapport de mélange : Le rapport de mélange représente la quantité
de vapeur d'eau en gramme que contient 1 kg d'air. Cet air ne pourra
contenir au maximum qu'une certaine quantité de vapeur d'eau qui va
dépendre de la pression et de la température de l'air, on l'appellera
rapport de mélange saturant. Plus l'air est chaud, plus il peut
contenir de vapeur d'eau. Le
rapport de mélange : Le rapport de mélange représente la quantité
de vapeur d'eau en gramme que contient 1 kg d'air. Cet air ne pourra
contenir au maximum qu'une certaine quantité de vapeur d'eau qui va
dépendre de la pression et de la température de l'air, on l'appellera
rapport de mélange saturant. Plus l'air est chaud, plus il peut
contenir de vapeur d'eau.
A l'inverse, pour une masse d'air contenant 6 g/kg de vapeur d'eau à 15°C,
en abaissant sa température (par une élévation par exemple), à 10°C elle
atteint la saturation. En abaissant encore sa température jusqu'à 0°C,
elle transformera 2g/kg de vapeur d'eau en eau liquide. C'est cette
transformation qui s'effectue dans une ascendance, à partir de la base du
cumulus.
Comment connaître le rapport de mélange saturant d'une masse d'air ? C'est
simple ! il faut connaître la valeur du point de rosée (Td).
Le point de rosée Td : Le point de
rosée de l'air est la température à laquelle l'air devient saturé en
vapeur d'eau. C'est le phénomène de condensation, qui survient lorsque le
point de rosée est atteint, qui créé les nuages et la brume.
La température de rosée Td dépend donc de l'humidité relative de l'air,
elle donnée par toutes les stations météo amateur, elle est aussi appelée
"Dew-point".
Emagramme complet :
L'émagramme complet va permettre de placer sur le
sondage, le point de rosée et la température de la bulle d'air au sol pour
en déterminer son plafond, avec ou sans formation nuageuse.

Les lignes tiretées fines représente le rapport de mélange pour une
température et une altitude.
A noter que lorsque je
remonte en suivant le rapport de mélange saturant, c'est comme si
je montais en effectuant un refroidissement de
0.2°C/100m. |
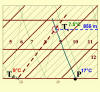 Données du problème : Données du problème :
Ma station météo me donne une température de 17°C et un point de rosée
à 9°C. A quelle altitude se trouve la base de mon cumulus ? Je place
mes températures sur l'émagramme. A partir des 17°C, je vais
tracer une courbe parallèle à l'adiabatique sèche qui correspond au
refroidissement adiabatique de ma bulle d'air qui s'élève.
A partir des 9°C de Td, je vais suivre cette fois le rapport de
mélange saturant qui est ici à 8g/kg à la rencontre de mon
adiabatique. A l'intersection des deux courbes se situe le point de
condensation à la température de condensation Tc de 7.5°C pour une
altitude de 850m. |
Un radiosondage est en
mesure de nous donner T et Td du sol jusqu'à 15 km d'altitude.
Sur un émagramme :
-Plus les
courbes T et Td seront rapprochées et plus l'air sera humide.
-Plus les
courbes T et Td seront écartées et plus l'air sera sec.
La couche d'atmosphère qui
nous intéresse est la couche convective. Pour nos tracés, nous utiliserons
Td au sol, mais il sera toujours intéressant d'observer l'écartement des
courbes T et Td en particulier au sommet de la couche convective. Lors de
la formation de cumulus, ceux ci se disperseront facilement si l'air est
sec (courbes écartées),mais il y aura risque d'étalement si l'air est
humide (courbes serrées).
Le sondage effectué à 00h00
est utilisé pour réaliser nos études. Mais l'utilisation de celui-ci n'est
peut être pas le plus judicieux, la masse d'air étant en perpétuelle
mouvement. L'air nous surplombant à 11h00 le matin n'a peut être plus rien
à voir avec celui-ci qui figure sur votre émagramme de 00h00. La solution
est de réaliser le sondage soi même,..., sinon, faute de moyen (SkyAssistant
par ex) ce sera la plus
part du temps le sondage Météofrance de 00h00 qui sera employé..
Le schéma ci-dessous montre
l'évolution de T et Td avec l'altitude, les deux courbes sont plus
espacées près du sol, l'air est sec, elles se resserrent au niveau de
l'inversion, marquant un air plus humide. Au-dessus de l'inversion,
l'écartement plus ou moins prononcé de ces deux courbes influencera la
couche nuageuse (de pas de cumulus à l'étalement).
Attention, le schéma
ci-dessous est un cas particulier de fin de journée de convection, la
couche convective ayant été brassée la journée, il s'effectue une
homogénéisation de l'air dans cette couche, les T et Td s'établissant avec
une décroissance régulière respective de -1°C/100m et -0.2°C/100m. Un
relevé du matin ne sera pas aussi régulier, en particulier près du sol à
cause du refroidissement nocturne.
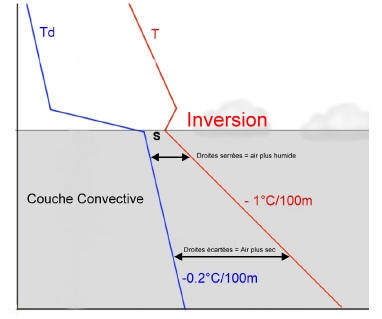
Travaux dirigés : Exercice complet d'étude de la masse d'air convective
mettant en oeuvre tout ce qu'on vient de voir, réalisable avec des moyens
simples.
Données du problème : sondage réalisé en basse
couche par un vol en modèle réduit vers 7 à 8 h le matin lorsque aucune
convection n'est encore établie, jusqu'à une altitude de 800m pour
avoir une vue très fine de la masse d'air nous surplombant, complété par
le sondage à 00h00 réalisé par Météofrance dans la région considérée pour les altitudes supérieures
à notre sondage, que l'on
récupère sur le site Internet dédié :
http://meteocentre.com/upper/france.html
Pour avoir la légende détaillée :
http://meteocentre.com/upper/rs_legende.php
|
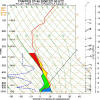 Radiosondage
Météo France Radiosondage
Météo France |
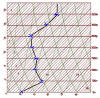 Sondage
perso + Météo France Sondage
perso + Météo France |
Tout l'art va être de prévoir l'évolution de la
température au sol au cours de la journée ainsi que la température maximun.
Pour être plus clair, si je veux faire de la
prévision, je dois être capable de dire : à 11h00, la température sera de
19°C, la convection démarre.
On peut facilement déterminer l'évolution des T° en
se fiant aux observations faites les jours précédents ou enregistrées par
une station météo perso si la nébulosité et la masse d'air ont des
caractéristiques identiques.
Étude de l'émagramme :

On peut déjà observer que la convection ne démarrera pas avant que la
température au sol de 19°C soit atteinte. En effet, l'inversion nocturne due au
refroidissement (par radiation) de l'air au contact du sol durant la nuit s'est propagée
jusqu'à 400m de hauteur. Les premiers mouvements convectifs vont se
réaliser dans cet espace mais ne seront pas vraiment établis et donc pas
facilement exploitables.
Ma station météo me donne la température de rosée Td
= 6°C. Ça me permet de tracer la courbe du rapport de mélange qui est ici de 6g/kg.
qui est ici de 6g/kg.
En observant l'émagramme, je constate que l'inversion
nocturne se sera résorbée que pour une température de 19°C. La
convection va réellement démarrer pour 19°C .
On constate par ailleurs que l'ascendance sera arrêtée par de l'air plus chaud avant
d'atteindre son point de saturation. .
On constate par ailleurs que l'ascendance sera arrêtée par de l'air plus chaud avant
d'atteindre son point de saturation.
Jusqu'alors l'ascendance était bloquée dans son ascension avant
d'atteindre sa température de saturation C'en est fini, dès 21°C, les
premières formations nuageuse vont se former.
Vers 16h l'après midi, la température est à son maximum de 24°C
... Que se passe t-il ?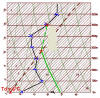
Une ascendance va partir du sol et s'élever en suivant un refroidissement
adiabatique. Vers 1800m d'altitude et 2.5°C, l'adiabatique sèche coupe la
courbe de rapport de mélange 6g/kg (issue de la T° de rosée Td =
6°C). A partir de là, l'air passe à saturation et s'élève en suivant cette
fois la pseudo-adiabatique. Le nuage est en formation, l'ascendance
continue son ascension jusqu'à croiser la courbe d'état du sondage. La bulle
ascendante rencontre à 3000m un air environnant à la même température de
-5°C, l'ascendance ne peut monter plus haut.
Notre ascendance monte à 3000m d'altitude, on ne
pourra exploiter que la partie non saturée jusqu'à l'altitude de 1800m, le
vol de nuage étant impossible pour le planeur RC et interdit en France
pour le planeur grandeur.
Pour information :
pour déterminer la hauteur de la base des cumulus, il est admis d'utiliser
la formule suivante :
Hbase
(m) = (T° - Td) x 120
Comment estimer la puissance de l'ascendance ?
La puissance de l'ascendance dépend du différentiel de température entre
la courbe d'état de la tranche d'atmosphère et l'adiabatique ou
pseudo-adiabatique.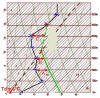
- de 0 à 1000m, l'écart entre
la courbe d'état et l'adiabatique est constant. Les Vz seront constantes
sur cette tranche.
- de 1000 à 1500m, on
constate un resserrement entre les deux courbe, les Vz diminuent
d'intensité.
- de 1500 à 1800m, l'écart
entre la courbe d'état et l'adiabatique est constant. Les Vz seront
constantes sur cette tranche.
- à partir de 1800m l'air
devient saturé et refroidit moins vite, créant une augmentation de l'écart
entre la courbe d'état et la pseudo-adiabatique. Dans le nuage
l'ascendance est à son maximum vers 2500m.
- à partir de 2500m, l'écart
diminue pour s'annuler à 3000m, la Vz devient nulle.
Pour information :
pour déterminer la vitesse moyenne des ascendances du jour, il est admis
d'utiliser la formule suivante. Ça donne surtout une bonne idée des
capacités convectives de la masse d'air :
Vz =
(√(2
x CAPE) )/2
On peut trouver le CAPE sur le sondage du
jour à 12h00. CAPE : Convective Available Potential
Energy en J/kg. C'est l'énergie potentielle disponible
(chaleur latente).
Juste une petite remarque à destination des
vélivoles RC ou grandeur : La valeur de l'ascendance dont on
parle ci-dessus n'est pas la vitesse avec laquelle votre planeur va
monter. Vous savez que votre planeur chute à 0.5m/s, la valeur de
l'ascendance est de 1.5m/s : votre planeur va monter de 1.5 - 0.5 = 1 m/s
Comment estimer la
couche nuageuse en octas ou 8ème ?
Nous avons vu plus haut que
ce qui allait être déterminant pour connaître la nébulosité du jour était
l'écartement des courbes T et Td au dessus de la couche d'inversion. L
'OSTIV donne d'après une étude statistique les valeurs suivantes qui sont un
bon indice :
Au niveau de
l'inversion :
- Écartement
T et Td supérieur à 7°C => 0 à 1/8ème de cumulus
- Écartement T et Td entre 7 et 4°C => 1 à 3/8ème de cumulus
- Écartement T et Td entre 4 et 2°C => 3 à 5/8ème de cumulus
- Écartement T et Td entre 2 et 0°C => 5 à 8/8ème de cumulus
Pour éviter les gros
développements des cumulus en altitude ou des étalements, des écarts
supérieurs à 15°C entre T et Td sont souhaitables au-dessus de l'inversion
(courbes allant en s'évasant).
Voilà donc un raccourci bien rapide, représentant le
minimum que tout vélivole RC ou grandeur doit connaître. Si vous avez
encore une bonne heure à tuer, je vous conseille vivement le travail de
Michel Mioche, cadre au CNVV de St Auban sur Durance à destination des
instructeurs vol à voile (animation PowerPoint).
Pour ceux qui souhaitent travailler sur un émagramme
papier, il n'y a qu'à imprimer, coller un vénilia transparent sur la
feuille et travailler avec des stylos feutres effaçables.
|